La médiathèque André Malraux propose actuellement « Et l’homme créa les dieux », exposition élaborée à partir de l’essai de Pascal Boyer, qui apporte des réponses novatrices sur les religions en s’appuyant sur des recherches en sciences du cerveau, en anthropologie, en psychologie et en biologie de l’évolution. Pour explorer un courant religieux relié à notre région, voici quelques pistes de lecture à l’occasion des 500 ans de la Guerre des paysans. Connaissiez vous cet épisode historique dans la région des « Trois Pays » ?
Un parallèle avec notre époque ?
« France, Allemagne, Suisse: trois pays mais une seule région. Le résultat d’une histoire unique », qu’explore depuis longtemps le musée des Trois pays à Lörrach. L’exposition « Ruptures 1525 : Guerre des paysans + anabaptisme » se tient jusqu’au 25 mai prochain et dans son introduction marque le parallèle avec notre époque : « Comme en 1525, 500 ans plus tard, beaucoup ont le sentiment de vivre une époque de grands bouleversements. Le passage du Moyen-Âge aux temps modernes vers 1500 est une césure dans tous les domaines de la vie – en Europe, une nouvelle vision sociale axée sur l’être humain et ses droits se substitue à celle de l’ancien ordre féodal. […] Nos actuelles conditions de vie sont elles aussi en pleine mutation. Numérisation, mondialisation, individualisation ou réchauffement climatique en sont les mots-clés. Les ruptures génèrent des peurs et des expériences collectives de crise. […] Mais en même temps, les ruptures inspirent de nouveaux courants de pensée et d’action et de nouvelles opportunités pour l’avenir.]
1525 La guerre des paysans, c’est quoi ?
La guerre des paysans est un conflit social et religieux qui a eu lieu dans le Saint-Empire romain germanique entre 1524 et 1526 dans diverses régions aujourd’hui réparties entre cinq pays européens (Allemagne, Autriche, France, Suisse, Italie). Les paysans sont la principale force de travail de l’époque, leur sort n’est pas uniforme mais les revendications porteront sur la liberté avec la suppression du servage et la reconnaissance d’une place égale à celle des nobles et du clergé, ainsi que sur le droit divin avec une demande d’éthique dans le droit civil et pénal et la fin de l’arbitraire seigneurial. Cette éthique, selon les insurgés, ne peut être fondée que sur les principes moraux portés par le message évangélique et est à l’origine du mouvement anabaptiste réformateur. (voir Guerre des paysans sur wikipedia)
Dans La Guerre des paysans : l’Alsace et la révolution du Bundschuh, 1493-1525 l’historien médiéviste Georges Bischoff raconte, avec une érudition qui n’exclut pas la verve et la truculence, les premières années du bouillonnant XVIe siècle dans le sud de l’espace rhénan et dans les régions limitrophes, Lorraine et Franche-Comté, alors que l’humanisme ébranlait de vieilles certitudes et que la Réforme s’éveillait. Au printemps 1525, en Alsace comme dans une grande partie du Saint-Empire romain germanique, les paysans prennent les armes au nom de l’Évangile pour promouvoir un monde fraternel, sans seigneurs ni maîtres. Leur emblème est le Bundschuh, le soulier à lacet des gens du peuple. Ils pillent les maisons religieuses, menacent les châteaux, rallient à leur cause l’immense majorité des villages et un grand nombre de villes. Mais leurs premiers succès se terminent rapidement dans un immense bain de sang.
Les amateurs d’histoire pourront aussi lire La croisade du duc de Lorraine contre les paysans révoltés d’Alsace en mai 1525 de Nicolas Volcyr de Sérouville. En mai 1525, le très catholique duc Antoine de Lorraine apprend que des bandes de paysans alsaciens s’infiltrent sur son territoire, tentant de soulever les pays lorrains et de les gagner à la Réforme luthérienne. Il lance alors une véritable croisade, qui fait près de 30 000 morts en six jours. Le sang coule littéralement à flots dans les villes de Lupstein, Saverne et Scherwiller. L’expédition du duc de Lorraine a été racontée peu après les faits par son secrétaire et historiographe, Nicolas Volcyr de Sérouville. Tel un reporter de guerre, mais aussi en propagandiste, il décrit avec précision les événements de cette Guerre des Paysans et les horreurs dont il a été le témoin direct. « Méfie-toi du Lorrain ! » Précepte alsacien du XVIe siècle.
Fryheit 1525 de Gabriel Schoettel (Le Verger, 2010) est un roman d’aventure historique ayant pour cadre l’Europe de la Réforme et les mouvements d’émancipation qui vont la secouer. Si Erasmus Gerber et le duc de Lorraine y conduisent les forces en présence, c’est à travers quelques destins singuliers que l’auteur montre l’histoire en marche. A commencer par celui d’Andreas, un vigneron de Marlenheim, rescapé du massacre qui a ensanglanté l’Alsace en 1525.
L’anabaptisme en Alsace
Adeptes d’un mouvement religieux protestant qui s’implante en Alsace, comme dans l’ensemble de la vallée rhénane (Hollande, Suisse, Palatinat, Wurtemberg), au XVIe siècle. Après 1525, Strasbourg devient l’un des principaux foyers de l’anabaptisme, qui touche 2% de la population. Après 1539, ils se dispersent dans les campagnes et la clandestinité et leur nombre recule peu à peu. Les anabaptistes établis en Alsace au XVIIe siècle se rallièrent à la tendance modérée et majoritaire du théologien hollandais Menno Simonsz d’où leur nom de « Mennonites », mais l’un des leurs, Jacob Ammann, de la communauté mennonite de Sainte-Marie-aux-Mines de 1693 à 1720, crée une mouvance dissidente de stricte observance, qui, minoritaire, amena ses adeptes à émigrer dans les provinces unies d’Amérique, où ils subsistent et maintiennent leur style de vie sous la dénomination d’« amish ». (source Anabaptistes — DHIALSACE)
Dans son roman Les frères amish (Presses de la Cité, 2013) Marie Kuhlmann retrace l’origine et la naissance du mouvement amish en Alsace au XVIIe siècle. En 1683, Frena et Elias Greiber, membres de la communauté anabaptiste suisse, une branche protestante persécutée depuis la Réforme, s’installent dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Là, sur les terres des Ribeaupierre où règnent tolérance et partage, un chef religieux radical, Jacob Amann, enseigne une nouvelle doctrine des plus strictes. Avec lui, Elias, disciple de la première heure, la douce Frena, leurs quatre enfants et quelques autres, tous alsaciens de naissance ou d’adoption, sont en train de fonder la communauté des amish. Le roman des racines des amish.
Jean-Christophe Grangé a paradoxalement situé l’une de ses enquêtes dans cet environnement religieux, avec Le jour des cendres (Albin Michel, 2020). En Alsace, un cadavre a été découvert dans une église. Il s’agit de celui d’un des responsables d’une communauté religieuse qui vit sur le modèle des anabaptistes et exploite un prestigieux vignoble. Le commandant Pierre Niémans et son adjointe Ivana Bogdanovitch mènent l’enquête. La jeune femme infiltre la communauté en se faisant passer pour une bénévole le temps des vendanges. Dans une communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ?
Enfin un ovni dans cette sélection, Les errances du mal de la portugaise Maria Gabriela Llansol (Métailié 1991). Sur la toile de fond menaçante de l’utopie portée par les hordes de pauvres anabaptistes assiégés dans Münster, Maria Gabriela Llansol conçoit un triangle amoureux formé par Copernic, Isabol et Hadewijch. A travers les pages érotiques les plus troublantes de la littérature portugaise, elle montre que l’hermaphrodite n’est pas la figure finale de l’humain et que le nombre impair maintient l’amour ouvert à la connaissance. » La séduction de ce livre est à la mesure du mystère qui enveloppe son propos. A la lecture, s’installe la conviction à la fois confuse et solide qu’un univers littéraire singulier, intensément personnel, se constitue. » Le Monde. A vous de voir…

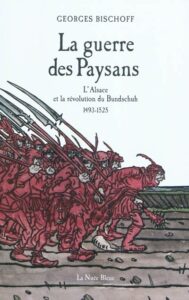
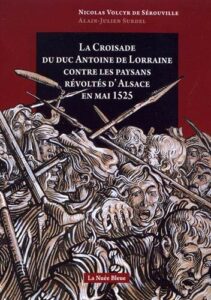

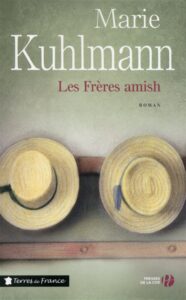
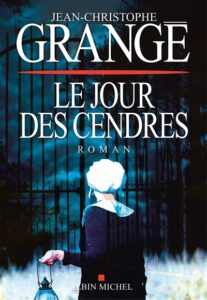
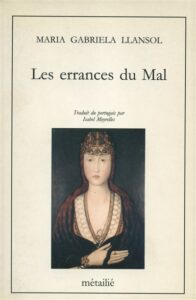



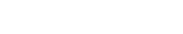
Laisser un commentaire